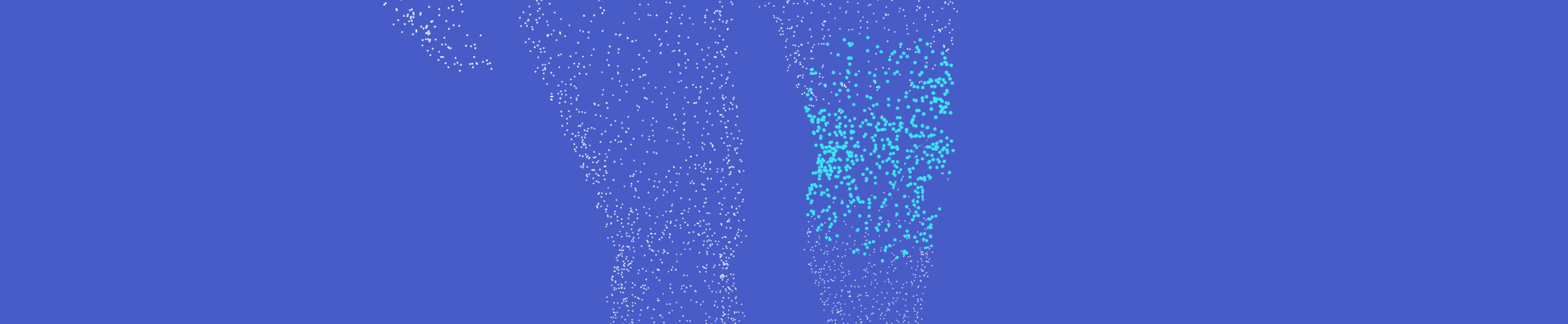
Il existe quatre principaux ligaments qui assurent la stabilité du genou.
Le ligament croisé antérieur relie la partie antérieure du tibia à la partie postérieure du fémur. Il empêche la translation antérieure du tibia par rapport au fémur et stabilise le genou lors des mouvements de rotation.
La rupture du ligament croisé antérieur survient le plus souvent au cours d’activités physiques (sport collectif avec pivot et contact : football rugby, basket… ou bien sport individuel en pivot : ski, tennis…). Le patient chute et perçoit alors un craquement dans son genou, avec une douleur intense mais souvent très courte. Lorsque la douleur devient tolérable, le blessé, qui tente de se relever, ne peut pas se tenir en appui sur le membre inférieur lésé qui est instable. Dans les heures qui suivent la rupture du ligament croisé antérieur, il faut noter un gonflement du genou en rapport avec un saignement intra articulaire.
L’interrogatoire est important car il oriente très souvent vers la recherche d’une lésion ou rupture du ligament croisé antérieur.
Dans un deuxième temps, le diagnostic repose sur la clinique avec un examen rigoureux du genou. Cet examen est plus facile juste après le traumatisme. En revanche, il est plus difficile à pratiquer 24 heures après, du fait du saignement intra articulaire et des hématomes qui provoquent chez le patient des douleurs associées à des contractions de défense et de protection. Cet examen redevient à nouveau plus facile à distance de la rupture de ligament croisé antérieur, lorsque les hématomes se sont résorbés et que le genou a récupéré toutes ses amplitudes articulaires.
Aujourd’hui, le diagnostic est confirmé par une IRM qui permet en plus de visualiser des lésions méniscales ou ostéo-cartilagineuses associées
Le ligament croisé antérieur n’a pas de potentiel de cicatrisation spontanée, permettant de retrouver une anatomie normale. Il persistera le plus souvent une laxité responsable d’une sensation de dérobement qui risque d’augmenter avec le temps.
Ce ligament est particulièrement sollicité, donc indispensable à la pratique des sports où il existe des changements de direction soudains, des impulsions et des réceptions. En cas d’insuffisance, le sportif risque des épisodes d’instabilité, perçus comme une nouvelle entorse et susceptibles de provoquer des lésions évolutives méniscales ou cartilagineuses. Cependant, même en cas de laxité, une activité sportive dans l’axe (vélo, jogging) est souvent bien tolérée. Le désir de poursuivre une activité sportive avec pivot justifie la réalisation d’une intervention chirurgicale visant à reconstruire le ligament croisé antérieur (ligamentoplastie) et donc à stabiliser le genou, évitant les lésions secondaires et la dégradation de l’articulation. L’âge de survenue de la rupture du ligament croisé antérieur est à prendre aussi en considération puisqu’il détermine le nombre d’années pendant lesquelles le genou sera soumis à des contraintes sportives.
Les résultats des ligamentoplasties sont maintenant connus avec un recul important. Ils sont très encourageants avec une disparition des épisodes d’instabilité dans la très grande majorité des cas.
L’intervention chirurgicale de ligamentoplastie suite à une rupture du ligament croisé antérieur du genou est pratiquée sous contrôle arthroscopique, à l’aide d’une petite caméra introduite dans le genou. Celle-ci permet de réduire les incisions et d’accéder à l’articulation, sans endommager les tissus.
Cette technique rend possible une récupération plus rapide après rupture du ligament croisé antérieur. Une courte incision permet de prélever les tissus qui constitueront le nouveau ligament : le tiers central du tendon rotulien pour la technique de Kenneth Johnes (ou KJ) ou les tendons ischio-jambiers de la cuisse pour la technique du DIDT (droit interne / demi tendineux). Le choix du transplant dépend de différents critères que prend en considération le chirurgien, mais les suites opératoires et les résultats de ces deux techniques sont similaires. Ce tendon sert à constituer le nouveau ligament. Il est placé dans le genou, à la place du ligament rompu. Le ligament est fixé dans un tunnel au fémur et dans un autre tunnel au tibia par des vis résorbables.
Dans certains cas particuliers de rupture du ligament croisé antérieur, il est parfois utile de renforcer la plastie par une ténodèse latérale, c’est-à-dire une plastie extra-articulaire utilisant : soit les tendons des ischio-jambier (le plus souvent), soit une bandelette tendineuse à la partie externe du genou qui nécessite la réalisation d’une incision supplémentaire. Les conséquences au niveau de la zone du prélèvement sont minimes, voire nulles. Les lésions des ménisques sont traitées dans le même temps opératoire. Une suture méniscale est réalisée pour conserver autant que possible l’intégrité des ménisques. En cas de lésion non réparable, la partie pathologique du ménisque est retirée.
Les deux techniques « Reconstruction du ligament croisé antérieur par une greffe tendineuse » et « Reconstruction du ligament croisé antérieur par technique out in biologique » sont présentées dans les vidéos de cet article.
L’intervention de reconstruction suite à une rupture du ligament croisé antérieur se fait en ambulatoire ou avec une hospitalisation d’une nuit, en fonction de votre souhait et de vos antécédents médicaux.
C’est l’anesthésiste qui décide de la meilleure anesthésie, selon de votre état de santé.
Après l’opération, un pansement stérile est appliqué pendant quelques jours. Un traitement de la douleur est mis en place, surveillé et adapté de manière très stricte dans la période post-opératoire.
La marche est autorisée dès le lendemain de l’intervention, avec l’aide de cannes anglaises et avec une mise en charge progressive qui peut être modulée en fonction du transplant utilisé. Il est important de mobiliser le genou dans l’ensemble de ses amplitudes articulaires et de débuter le réveil musculaire en post-opératoire immédiat. Le patient doit réaliser un certain nombre d’exercices à domicile en auto-rééducation, afin d’entretenir ce qu’il a appris avec le kinésithérapeute.
L’arrêt de travail dure entre un et trois mois, en fonction de l’activité professionnelle. Il est possible de reconduire un mois après l’intervention.
Des visites de contrôle sont prévues à trois semaines de l’intervention puis à six semaines, enfin à trois, six, douze et 24 mois. Voir la plaquette : « Retour à domicile après une ligamentoplastie antérieure du genou »
Après intervention chirurgicale de ligamentoplastie suite à une rupture du ligament croisé antérieur, la rééducation s’effectue avec un kinésithérapeute de ville et ne nécessite pas de centre de rééducation, sauf cas particulier.
La rééducation et la cicatrisation du transplant ont lieu au cours de la période post-opératoire et sont toutes les deux essentielles à l’obtention d’un bon résultat final.
La cicatrisation est particulièrement importante dans les quatre premiers mois post-opératoires. Il est essentiel de suivre scrupuleusement les recommandations qui vous seront données par le chirurgien, le médecin du sport ou le kinésithérapeute. Dans un premier temps, le but est de réduire les douleurs initiales en préservant la souplesse, puis de récupérer les muscles et les sensations dans un second temps.
La rééducation suite à l’intervention chirurgicale sur une rupture du ligament croisé antérieur se décompose en quatre phases :
Exercices d’auto-rééducation après chirurgie consécutive à une rupture du ligament croisé antérieur : » Rééducation J0 à J8 » Rééducation J8 à J15
En plus des risques communs à toute intervention chirurgicale et des risques liés à l’anesthésie, il existe quelques problèmes spécifiques à cette chirurgie réparatrice qui fait suite à une rupture du ligament croisé antérieur.
La raideur articulaire est la plus fréquente. Elle se développe sur un terrain inflammatoire (algodystrophie) et nécessite, en cas de survenue, une rééducation adaptée. À partir du troisième mois post-opératoire, s’il persiste un déficit dans les amplitudes articulaires, la fibrose qui s’est constituée nécessitera une intervention chirurgicale pour récupérer les amplitudes.
La survenue d’une infection est très rare du fait de l’utilisation de l’arthroscopie. Elle nécessite un lavage du genou et la mise en place d’un traitement antibiotique qui permet la guérison. Malgré un traitement anticoagulant préventif mis en place pendant la période post-opératoire et le port de bas de contention, un caillot peut se former dans les veines du membre inférieur (phlébite) et nécessiter la mise en place d’un traitement anticoagulant à dose curative de façon prolongée.
Le ligament croisé antérieur remplacé présente à peu près le même risque de se rompre à nouveau que le ligament de votre autre genou, a fortiori si vous reprenez les mêmes activités sportives.
Les risques énumérés ne constituent pas une liste exhaustive. Votre chirurgien donnera toute explication complémentaire et se tiendra à votre disposition pour évoquer avec vous chaque cas particulier avec les avantages, les inconvénients et le rapport bénéfices / risques de chaque intervention liée à une rupture du ligament croisé antérieur.