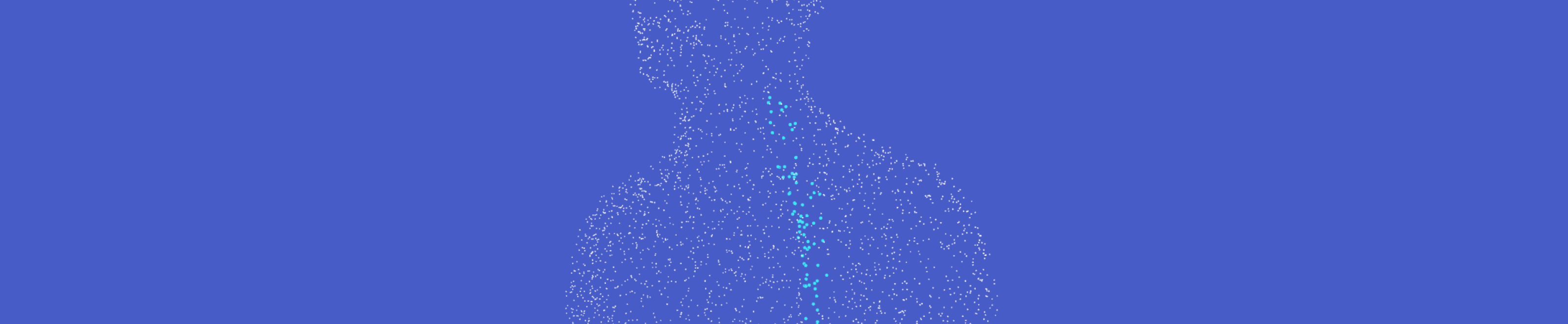
Le disque intervertébral lombaire est une pièce « d’usure » de la colonne vertébrale. Il possède deux parties : un anneau périphérique ou annulus fibrosus, véritable joint d’étanchéité du disque, et un noyau rempli de gel amortisseur, appelé nucleus pulposus.
Avec l’usure, le noyau se fragmente en plusieurs parties et perd son eau.
En cas de déchirure de l’anneau (par traumatismes répétés), un fragment de noyau peut sortir du disque par cette « fuite » : c’est la hernie discale.

La déchirure du disque entraîne une inflammation locale responsable d’une contracture réflexe : c’est le lumbago. Le fragment de hernie discale, s’il migre en direction d’une racine nerveuse (dans le canal rachidien ou à la sortie de celui-ci), entraîne une irritation de cette racine. L’irritation provoque une douleur dans le trajet des fibres nerveuses correspondant à la racine, c’est-à-dire une sciatique ou une cruralgie, ou les deux.
La douleur concerne donc le membre inférieur situé du côté de la hernie discale lombaire (gauche pour une migration dans la partie gauche du canal par exemple). L’irritation nerveuse peut entraîner une paralysie (partielle ou complète) dans le membre inférieur concerné, des troubles sphinctériens (par irritation des racines sacrées), ou une douleur très vive empêchant le patient de dormir (sciatique hyperalgique). Dans ces trois cas, une chirurgie doit être réalisée en urgence pour soulager la racine.
En l’absence de critère de gravité inhérent à la hernie discale lombaire, la douleur doit être traitée médicalement (repos, anti-inflammatoires, traitement antalgique fort) dans un premier temps. En cas de sciatique rebelle au traitement médical pendant plus de trois mois, on peut porter l’indication d’une chirurgie si l’imagerie met en évidence un fragment discal concordant bien avec la symptomatologie du patient.
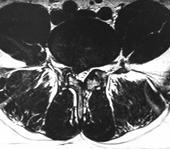
Le repos strict au lit est recommandé pendant 2 semaines. Les positions à éviter avec une hernie discale lombaire sont la position assise prolongée, la position debout immobile.
Le traitement médical doit amener une guérison complète de la douleur radiculaire (sciatique, cruralgie) en moins de trois mois. Dans le cas contraire, ou en cas d’urgence chirurgicale, c’est la chirurgie qui est recommandée.
Après avoir revu de nombreux cas de hernies discales lombaires, cet auteur a défini les critères de sélection d’un patient pour une indication chirurgicale :

La chirurgie est indiquée soit en urgence (sciatique paralysante, hyperalgique, syndrome de la queue de cheval), soit après échec du traitement médical.
Le but de l’opération est de supprimer l’irritation de la racine nerveuse en supprimant sa cause : la hernie discale lombaire.
L’indication de chirurgie est portée par le chirurgien, et nécessite un consentement éclairé du patient.
Le chirurgien doit expliquer les causes des douleurs au patient, l’évolution possible en l’absence de traitement, le traitement nécessaire, avec ses contraintes et risques propres.
L’intervention se déroule sous anesthésie générale. Une consultation avec le médecin anesthésiste est donc obligatoire avant toute intervention sur une hernie discale lombaire.
Le chirurgien aborde la colonne vertébrale par l’arrière. L’incision cutanée est centrée sur le niveau discal à opérer (un contrôle radiographique est réalisé systématiquement avant l’incision) et latéralisée selon le côté de la douleur du membre inférieur. Elle mesure en moyenne 2,5 cm. L’utilisation d’un microscope, d’une technique endoscopique ou d’un tube avec grossissement optique dépend de l’habitude du chirurgien.
L’ouverture du canal vertébral (qui contient les racines nerveuses et la hernie discale lombaire) étant réalisée, le chirurgien doit repérer la racine nerveuse qui souffre. Il doit la libérer progressivement de la hernie discale, puis procéder à l’exérèse de celle-ci.
La durée d’intervention est variable de 15 à 45 minutes, en fonction du niveau opéré, de la corpulence du patient, et de l’étroitesse relative du canal vertébral. Un drainage est rarement indiqué.
Elle est en moyenne d’une nuit : le patient voit le kinésithérapeute à son entrée (la veille ou le jour même), se lève avec le kinésithérapeute le jour de l’intervention et retourne chez lui le lendemain en général.
Durant six semaines, le patient doit suivre des consignes d’hygiène vertébrale pour éviter toute récidive de hernie discale lombaire : la position assise est à éviter pendant trois semaines (donc les transports en automobile), ainsi que le port de charge (porte-à-faux). La marche est recommandée, ainsi que le repos couché.
La reprise d’une vie normale est possible six semaines après l’intervention. Une rééducation est possible pour réaliser des exercices de gainage du tronc, d’étirements des membres inférieurs et l’apprentissage des principes de l’école du dos.
La reprise du travail est possible six semaines après l’intervention en cas de métier sédentaire.
La reprise de travail sera plus tardive en cas de métier de force (quatre à six mois).
La reprise du sport se fait progressivement à partir du quatrième mois. La reprise du sport de compétition est possible entre six et huit mois après l’intervention et après un reconditionnement physique à l’effort.